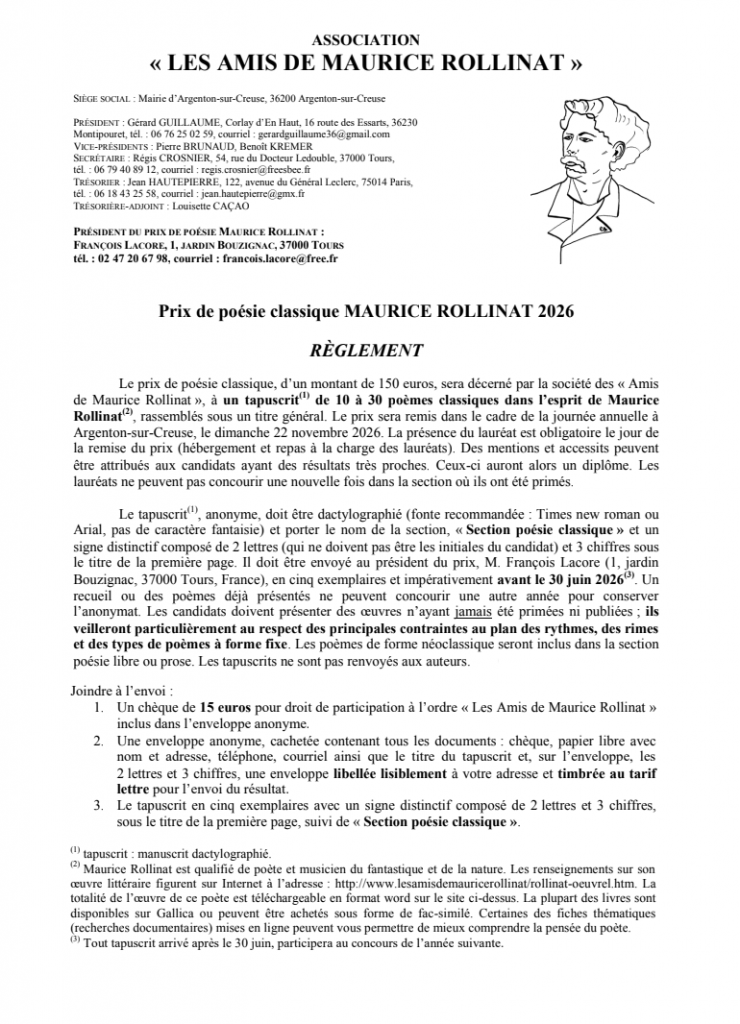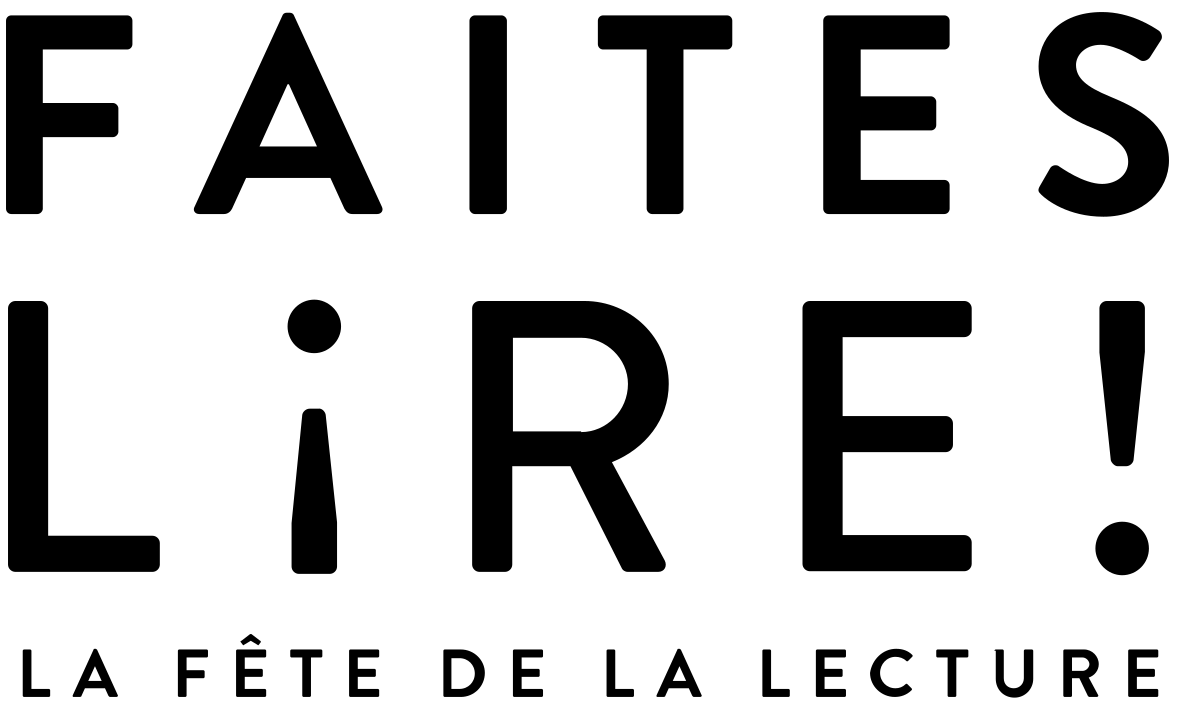Albina OLIVIERA DOS REIS
Ressemblances
Une femme à sa fenêtre, regarde le vent racler la vitre —ce n’est pas l’hiver qui mord, mais le souffle ancien
d’un monde trop clos.
Elle se consume, dans la morsure des heures, dans l’ombre des gestes,
les gestes infimes, invisibles,
des jours sans nom, des souffles sans mémoire,
qu’on lui a légués, comme une pluie de
cendres oubliées.
Femme, tu mets au monde un corps sans fin,
le même — toujours
le tien,
tu es la ressemblance qu’on arrondit, qu’on modèle,
pour qu’elle rentre dans des cadres qui te sont étrangers.
Comme elle portait la résille, la rime tremblait,
puis tout à coup, elle a flamboyé: au lieu de me cacher dans l’ombre,
tremblante, aux profondeurs de la cale,
j’ai voulu m’élever sur le pont, le cœur battant contre l’écume.
À l’écart, mais debout —
j’ai vu les vagues hurler leur déraison,
le ciel saigner de silence,
l’horizon dévorer la mer sans retour.
Et là, j’ai su.
Préférer l’orage à l’attente,
le vertige à la cage,
le cri à l’oubli.
Alors, à deux mains, j’ai lancé par-dessus bord
les vagues vers de mon âme.
Qu’ils sont fragiles, amassés page après page, je les ai
confiées aux courants,
non pour qu’elles s’éteignent,
mais pour qu’elles laissent une trace,
qu’elles fendent l’air,
qu’elles tremblent encore,
à la surface de cette mer qui me dépasse.
Je suis femme. Et une femme n’est pas une vie déchiquetée,
une parole suspendue dans le vide de vers inachevés.
Depuis le premier jour, j’ai tout eu en moi,
ce souffle, ce feu, ce que tout ce que le monde m’a caché.
Mais maintenant, je me souviens.
Je suis battante, comme l’eau je suis éclatante
mais je cherche encore —
mes sœurs.
Celles qui écrivent dans le noir,
celles qui chantent en silence, celles qui lancent leurs vers dans les vagues de l’histoire,
plutôt que de sombrer dans l’oubli, que de couler sous l’assommoir du temps.
Et ensemble, nous ferons flotter nos voix,
nos vies, nos colères, jusqu’à ce que la mer
nous appelle par nos noms
et que le monde,
enfin,
entende notre chant.